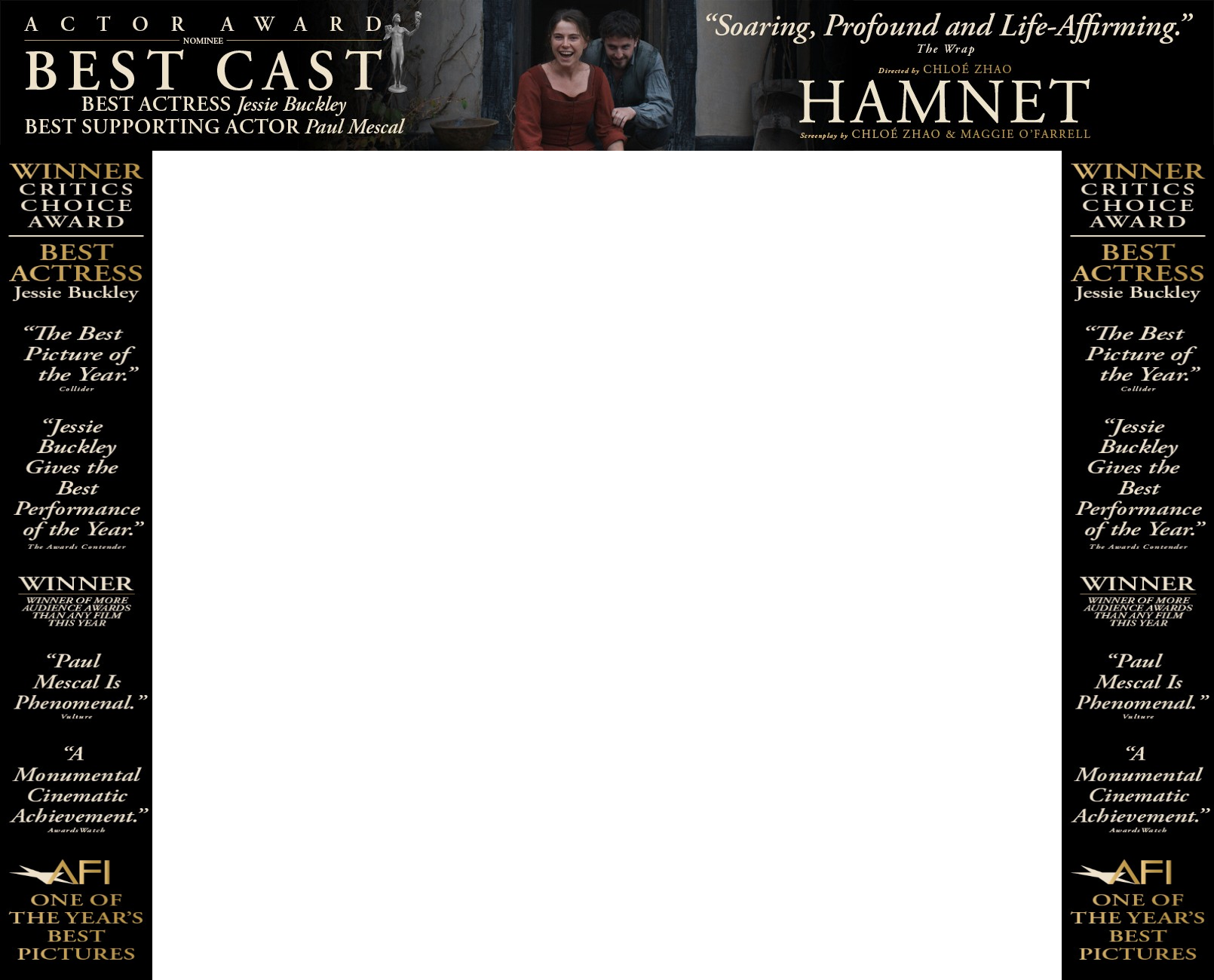Lumière 2025 – [Entretien] Maelle Arnaud : "Le festival est un déclencheur de restaurations"
Date de publication : 16/10/2025 - 08:10
Rencontre avec sa directrice de la programmation du festival lyonnais. L’occasion de scruter les coulisses éditoriales de l’évènement, tout en abordant le rôle et les enjeux patrimoniaux de l’Institut Lumière, dont elle est aussi la programmatrice et responsable de la collection des films.
Vous programmez le Festival Lumière depuis sa fondation, comment a évolué ce travail au long de ces 17 éditions ?
En fait, cette 17e édition héberge un peu plus de 150 films, pour environ 425 séances. Soit une évolution concrète depuis la première édition, qui était sur cinq jours et hébergeait 70 films pour 130 séances. On peut y voir l’expression de notre envie de développer ce festival, et d’immerger Lyon dans le cinéma et les films qui ont jalonné son Histoire.
En fait, cette 17e édition héberge un peu plus de 150 films, pour environ 425 séances. Soit une évolution concrète depuis la première édition, qui était sur cinq jours et hébergeait 70 films pour 130 séances. On peut y voir l’expression de notre envie de développer ce festival, et d’immerger Lyon dans le cinéma et les films qui ont jalonné son Histoire.
Sous quels auspices avec-vous placé la programmation cette 17e édition ?
Quand nous travaillons cette programmation avec Thierry Frémaux et toute l'équipe, notre première considération est de savoir quelle histoire du cinéma chaque édition doit raconter. En 2025, alors que la fréquentation des salles a été particulièrement faible, nous avons voulu une édition foisonnante, d’une grande diversité, avec l’envie de raviver chez les spectateurs le plaisir de découvrir des films en salle. L’idée est de rappeler qu'aller au cinéma est une fête et une joie, qui font partie de nos vies depuis 130 ans. Ce programme est aussi caractérisé par un regard poussé vers l’Amérique, les Etats-Unis – dont la situation actuelle n’est pas très heureuse. Nous souhaitons rappeler tout notre amour du cinéma américain, un territoire exceptionnel dans l'Histoire du cinéma. Parallèlement, nous avons un angle asiatique important, caractérisé par la rétrospective de Seijun Suzuki et des invitations à Shu Qi ou John Woo. Sans oublier, et cela fait des années qu’il marque très fortement notre festival, un axe sur le cinéma d'Europe de l'Est. Nous avons par exemple invité István Szabó pour évoquer son parcours et son œuvre, qui ont traversé la deuxième moitié du XXe siècle.
Quand nous travaillons cette programmation avec Thierry Frémaux et toute l'équipe, notre première considération est de savoir quelle histoire du cinéma chaque édition doit raconter. En 2025, alors que la fréquentation des salles a été particulièrement faible, nous avons voulu une édition foisonnante, d’une grande diversité, avec l’envie de raviver chez les spectateurs le plaisir de découvrir des films en salle. L’idée est de rappeler qu'aller au cinéma est une fête et une joie, qui font partie de nos vies depuis 130 ans. Ce programme est aussi caractérisé par un regard poussé vers l’Amérique, les Etats-Unis – dont la situation actuelle n’est pas très heureuse. Nous souhaitons rappeler tout notre amour du cinéma américain, un territoire exceptionnel dans l'Histoire du cinéma. Parallèlement, nous avons un angle asiatique important, caractérisé par la rétrospective de Seijun Suzuki et des invitations à Shu Qi ou John Woo. Sans oublier, et cela fait des années qu’il marque très fortement notre festival, un axe sur le cinéma d'Europe de l'Est. Nous avons par exemple invité István Szabó pour évoquer son parcours et son œuvre, qui ont traversé la deuxième moitié du XXe siècle.
Vous rattachez-vous toujours fortement à l’actualité des restaurations ?
Pas forcément. Disons que, pour schématiser, notre programmation s’articule autour de trois types de démarches. Tout d’abord, celle où un distributeur spécialisé dans le cinéma classique nous propose une rétrospective clé en main ou presque. En cela, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de nos collègues distributeurs, comme cette année Carlotta Films autour de l’œuvre de Seijun Suzuki ou Malavida Films pour celle de la cinéaste norvégienne Anja Breien. Il y a ensuite les rétrospectives que nous construisons à partir du matériel déjà existant, souvent issu du patrimoine français. Cela nous permet de travailler avec des restaurations existantes, en collaborant avec tous les ayant-droits et catalogues. Enfin, nous avons aussi, et c’est assez singulier, une démarche très proactive - liée à une envie de programmation mais dont le matériel est, en l’état, indisponible. Nous devenons alors le déclencheur des restaurations et numérisations. C’est une grande fierté de constater que la force de frappe du festival, même auprès des grands studios américains (comme c’est le cas cette année avec Martin Ritt), permet de faire exister ces nouvelles copies, qui deviennent ensuite disponibles sur le marché français et dans les salles. Ici, non seulement le Festival Lumière remplit ses fonctions d'acteur culturel, via sa programmation, mais il joue aussi un rôle actif dans l'économie globale du secteur.
Pas forcément. Disons que, pour schématiser, notre programmation s’articule autour de trois types de démarches. Tout d’abord, celle où un distributeur spécialisé dans le cinéma classique nous propose une rétrospective clé en main ou presque. En cela, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de nos collègues distributeurs, comme cette année Carlotta Films autour de l’œuvre de Seijun Suzuki ou Malavida Films pour celle de la cinéaste norvégienne Anja Breien. Il y a ensuite les rétrospectives que nous construisons à partir du matériel déjà existant, souvent issu du patrimoine français. Cela nous permet de travailler avec des restaurations existantes, en collaborant avec tous les ayant-droits et catalogues. Enfin, nous avons aussi, et c’est assez singulier, une démarche très proactive - liée à une envie de programmation mais dont le matériel est, en l’état, indisponible. Nous devenons alors le déclencheur des restaurations et numérisations. C’est une grande fierté de constater que la force de frappe du festival, même auprès des grands studios américains (comme c’est le cas cette année avec Martin Ritt), permet de faire exister ces nouvelles copies, qui deviennent ensuite disponibles sur le marché français et dans les salles. Ici, non seulement le Festival Lumière remplit ses fonctions d'acteur culturel, via sa programmation, mais il joue aussi un rôle actif dans l'économie globale du secteur.
Vous dirigez aussi la programmation de l’Institut Lumière, en quoi est-elle liée au festival ?
L’Institut Lumière héberge plus d’un millier de séances par an, pour 126 000 spectateurs environ la saison dernière. Ce qui reste remarquable sachant que nous fonctionnons presque comme un mono-écran – nous n’utilisons que ponctuellement la salle de 70 places de la Villa Lumière, en complément de la grande du Hangar du Premier-Film (et ses 269 fauteuils, Ndr). En termes de programmation, il existe des liens évidents, quoique souvent occasionnels. Ce peut-être autour de la reprise d’une rétrospective ou d’une nouvelle restauration montrées au festival - une façon, déjà, de sensibiliser sur un cinéaste ou une œuvre. Le plus important pour nous, pour chaque programme de l’Institut, est de ne jamais renoncer à une certaine exigence de programmation, mais sans perdre de vue notre rôle de transmission, de sensibilisation et de construction du public. Les chiffres montrent effectivement que les Lyonnais répondent présents.
L’Institut Lumière héberge plus d’un millier de séances par an, pour 126 000 spectateurs environ la saison dernière. Ce qui reste remarquable sachant que nous fonctionnons presque comme un mono-écran – nous n’utilisons que ponctuellement la salle de 70 places de la Villa Lumière, en complément de la grande du Hangar du Premier-Film (et ses 269 fauteuils, Ndr). En termes de programmation, il existe des liens évidents, quoique souvent occasionnels. Ce peut-être autour de la reprise d’une rétrospective ou d’une nouvelle restauration montrées au festival - une façon, déjà, de sensibiliser sur un cinéaste ou une œuvre. Le plus important pour nous, pour chaque programme de l’Institut, est de ne jamais renoncer à une certaine exigence de programmation, mais sans perdre de vue notre rôle de transmission, de sensibilisation et de construction du public. Les chiffres montrent effectivement que les Lyonnais répondent présents.
Quel regard portez-vous sur la politique de restauration et numérisation des œuvres en France ?
On ne peut que s'incliner, tant elle est jalousée par bien des pays. Pour avoir des relations constantes avec les archives et institutions de nombreux territoires, que l’on accueille justement au Festival Lumière, on peut témoigner que l’exemple français a déclenché la relance de politiques de restauration à l’international. Nous sommes heureux de démontrer grâce au festival comme au Marché international du Film classique, créé ici à Lyon, que le cinéma classique est vivant, que les œuvres circulent et qu’il existe un marché. Et tout cela, grâce au modèle français. Le CNC continue de soutenir les restaurations et reste au côté de nombreux ayant-droits. C’est une grande chance. Le tout forme un cercle vertueux. Nous avons créé le MIFC dans l’optique de soutenir un business déjà existant et participer à sa structuration. Il s’est depuis renforcé. C’est très intéressant de lier un projet culturel comme ce festival organisé par une cinémathèque, à la réalité d’un milieu économique, auquel on participe et que l’on encourage et alimente. Cela dit, chaque pays ou presque a aujourd’hui sa politique de restauration. Aujourd’hui, pour former notre sélection Lumière Classique au sein du festival, nous recevons désormais 180 propositions du monde entier. C'est quand même un signal fort.
On ne peut que s'incliner, tant elle est jalousée par bien des pays. Pour avoir des relations constantes avec les archives et institutions de nombreux territoires, que l’on accueille justement au Festival Lumière, on peut témoigner que l’exemple français a déclenché la relance de politiques de restauration à l’international. Nous sommes heureux de démontrer grâce au festival comme au Marché international du Film classique, créé ici à Lyon, que le cinéma classique est vivant, que les œuvres circulent et qu’il existe un marché. Et tout cela, grâce au modèle français. Le CNC continue de soutenir les restaurations et reste au côté de nombreux ayant-droits. C’est une grande chance. Le tout forme un cercle vertueux. Nous avons créé le MIFC dans l’optique de soutenir un business déjà existant et participer à sa structuration. Il s’est depuis renforcé. C’est très intéressant de lier un projet culturel comme ce festival organisé par une cinémathèque, à la réalité d’un milieu économique, auquel on participe et que l’on encourage et alimente. Cela dit, chaque pays ou presque a aujourd’hui sa politique de restauration. Aujourd’hui, pour former notre sélection Lumière Classique au sein du festival, nous recevons désormais 180 propositions du monde entier. C'est quand même un signal fort.
Ce dynamisme s’est accéléré et simplifié avec la numérisation de l'industrie ces 15 dernières années. Rencontrez-vous encore des difficultés à votre niveau pour programmer certaines œuvres ?
Tout à fait. Il existe encore beaucoup d’œuvres marquantes, importantes, plongées dans des imbroglios juridiques les bloquent et empêchent toute restauration ou diffusion. Après, avec l’expérience, ce type de situation finit toujours par se décanter avec le temps. On peut encore citer l’exemple de Vol au-dessus d’un nid de coucou, dont nous présentons la copie restaurée à Lumière cette année : le film est resté inaccessible pendant plusieurs décennies. Notre autre souci est plus générationnel. Par exemple, il faut faire accepter le constat que les années 2000, qui peuvent paraître encore récentes aux yeux de certains, entrent désormais dans l’Histoire du cinéma, et que ces films doivent susciter le même soin que ceux des précédentes décennies. D’autant qu’ils attirent un public différent, plus jeune, qui en a entendu parler ou les a découverts sur d’autres écrans, et souhaite désormais les voir en salle. L’éloignement dans le temps redonne en fait un certain éclat aux œuvres, et les jeunes cinéphiles y sont sensibles. C’est là aussi notre rôle de les accompagner.
Tout à fait. Il existe encore beaucoup d’œuvres marquantes, importantes, plongées dans des imbroglios juridiques les bloquent et empêchent toute restauration ou diffusion. Après, avec l’expérience, ce type de situation finit toujours par se décanter avec le temps. On peut encore citer l’exemple de Vol au-dessus d’un nid de coucou, dont nous présentons la copie restaurée à Lumière cette année : le film est resté inaccessible pendant plusieurs décennies. Notre autre souci est plus générationnel. Par exemple, il faut faire accepter le constat que les années 2000, qui peuvent paraître encore récentes aux yeux de certains, entrent désormais dans l’Histoire du cinéma, et que ces films doivent susciter le même soin que ceux des précédentes décennies. D’autant qu’ils attirent un public différent, plus jeune, qui en a entendu parler ou les a découverts sur d’autres écrans, et souhaite désormais les voir en salle. L’éloignement dans le temps redonne en fait un certain éclat aux œuvres, et les jeunes cinéphiles y sont sensibles. C’est là aussi notre rôle de les accompagner.
Propos recueillis par Sylvain Devarieux
© crédit photo : Institut Lumière - Photo O. Chassignole
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici