
Lumière MIFC 2025 - [Entretien] Sabrina Joutard (SCFP) : "Préserver notre patrimoine, une responsabilité collective"
Date de publication : 15/10/2025 - 08:00
La présidente du Syndicat des catalogues de films de patrimoine (SCFP) salue l’effort budgétaire du CNC en faveur de la restauration des oeuvres, mais alerte sur l’insuffisance des moyens face aux enjeux de conservation, de diffusion et de numérisation. Elle appelle à une mobilisation collective pour faire du patrimoine un levier stratégique, en France comme en Europe.
Depuis l’annonce du plan de soutien au patrimoine par la Ministre de la Culture l’an dernier, où en sont les discussions et quelles actions concrètes en attendez-vous ?
La bonne nouvelle de la fin 2024 a été l’annonce par Rachida Dati d’un renforcement du plan de soutien au patrimoine. L’augmentation d’1 million d’euros de l’enveloppe du CNC consacrée à la restauration a porté le budget annuel à 3,6 M€. Cette avancée a permis d’ouvrir une troisième commission sélective et donc de soutenir plus de 40 oeuvres supplémentaires chaque année. Ce geste a apporté un souffle indispensable à notre filière.
Mais le constat reste clair : les moyens demeurent insuffisants. Si les catalogues sont désormais reconnus comme des actifs stratégiques, l’aide dédiée à leur restauration ne représente encore que 0,4 % du budget global du CNC. Dans un contexte où ce budget a progressé de près de 50 M€ en 2023 et de 20 M€ en 2024, nous espérions franchir le cap symbolique d’1 % pour le patrimoine, incluant ainsi le sujet de la préservation des oeuvres.
La question de la conservation reste en effet aujourd’hui entière. Les coûts, très lourds, reposent uniquement sur les catalogues. Nous appelons donc à une concertation large — CNC, industries techniques, CST, organisations professionnelles du cinéma et de l’audiovisuel — afin de repenser la chaîne de préservation. Les formats évoluent, nos méthodes doivent évoluer aussi : tris réguliers avec les laboratoires, mutualisation des sites de stockage, choix raisonné des formats à conserver… Il est temps d’ouvrir ce débat. Nous sommes confiants dans la possibilité de faire progresser ces enjeux aux côtés des équipes du CNC. Préserver notre patrimoine ne peut plus être reporté : c’est une responsabilité collective.
En parallèle, Michel Gomez a été missionné pour un rapport sur le patrimoine audiovisuel. Avez-vous des attentes particulières sur un segment proche du vôtre ?
Nous nous réjouissons que le Ministère de la Culture et le CNC aient confié cette mission à Michel Gomez. Bien que notre syndicat se concentre principalement sur le patrimoine cinématographique, nous partageons avec le secteur audiovisuel des enjeux communs, notamment la numérisation, la diffusion et la préservation des oeuvres.
Ce rapport constituera un éclairage précieux sur nos problématiques quotidiennes, avec toutefois une différence notable : la filière cinéma a déjà pris de l’avance sur l’entretien de ses catalogues. L’échange avec Michel Gomez a été très enrichissant, nous permettant de partager notre retour d’expérience sur ce qui a fonctionné, ce qui reste à améliorer, et les défis encore à relever dans notre secteur.
Nous remercions également le MIFC de l’organisation d’une table ronde sur ce sujet le 15 octobre à Lyon, qui constituera une belle occasion d’échanger et de construire une vision commune pour les chantiers futurs, tant dans l’audiovisuel que dans le cinéma.
Nous tenons enfin à souligner un point de vigilance. Nous sommes convaincus que les travaux engagés dans l’audiovisuel et ceux du cinéma peuvent se renforcer mutuellement. Il nous semble toutefois essentiel que chacun puisse avancer en respectant ses équilibres budgétaires propres, afin de préserver la dynamique déjà engagée dans notre filière, tout en ouvrant la voie à des coopérations futures lorsque les conditions le permettront.
Alors que le programme Media entre dans une nouvelle phase, quel bilan tirez-vous du dispositif actuel en faveur du patrimoine et comment percevez-vous Media+, très décrié par la profession ?
Aujourd’hui, le patrimoine est l’un des grands oubliés du programme MEDIA. Depuis plusieurs années, avec le soutien du CNC et d’EUROCINEMA, nous militons pour que le programme intègre la numérisation des oeuvres, favorise leur diffusion à travers l’Europe et garantisse leur préservation. Nous proposons notamment de conditionner les aides européennes à la conservation sur le sol européen d’un jeu de matériel technique des oeuvres, afin d’éviter que certains acteurs non européens s’approprient des éléments essentiels des films produits ou coproduits avec des partenaires notamment français. Cette proposition a trouvé un écho auprès de la Cour des comptes, du sénateur Jérémy Bacchi, ainsi que du conseiller d’État Fabien Raynaud, qui l’a reprise dans son rapport publié en novembre 2024.
Avec l’émergence de MEDIA+, nous espérions une révision des critères d’attribution et un bilan des précédents programmes. Or, le paradoxe est frappant : on demande aux catalogues de rendre les oeuvres visibles dans toute l’Europe sans se pencher sur les obstacles à cette diffusion. La numérisation reste un frein majeur : il est impossible de proposer aux diffuseurs des films uniquement en photochimique ou dans des formats numériques obsolètes.
Depuis le lancement des discussions sur la réforme AgoraEU, le SCFP soutient activement les démarches d’EUROCINEMA et des autres coalitions européennes de la filière. Le dernier Festival international du film de San Sebastián a été l’occasion de rappeler les risques de cette réforme pour la création audiovisuelle indépendante. Si l’ambition de la Commission européenne — augmenter le budget, renforcer l’écosystème média, soutenir le pluralisme et la liberté de la presse — mérite d’être saluée, MEDIA+ s’éloigne dangereusement de l’esprit fondateur du programme. Pilier historique de la diversité culturelle en Europe, MEDIA se dilue désormais dans un vaste ensemble mêlant audiovisuel, médias d’information et lutte contre la désinformation, tout en affaiblissant les critères d’indépendance, en ouvrant le financement aux acteurs non européens et en centralisant les décisions à la Commission. Nous appelons à restaurer l’indépendance comme condition obligatoire de soutien, à garantir des budgets clairs et dédiés, et à préserver la souveraineté culturelle européenne : un impératif pour que l’innovation ne se fasse pas au détriment du patrimoine audiovisuel.
Un an après l’opt-out des membres du SCFP face à l’IA générative, quelles avancées avez-vous observées dans les discussions avec les ayants droit ?
Depuis un an, beaucoup de choses ont évolué autour de l’IA générative et de son impact sur la création audiovisuelle. Le SCFP a été très attentif et a participé à l’ensemble des discussions, et il est clair que le sujet est devenu central dans les instances publiques et professionnelles.
Plusieurs missions ont été menées – et certaines sont en cours - pour analyser ces enjeux : au Sénat, au Ministère de la Culture, ainsi que les différentes initiatives du CSPLA, incluant plusieurs rapports fondamentaux sur la question de la protection du droit d’auteur, comme ceux des professeures d’université, Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy.
Parallèlement, les litiges se multiplient, tant en France qu’à l’international : procès dans le secteur de la presse et de l’édition en France, et aux États-Unis, affaires impliquant Disney, Universal ou Warner, qui interrogent sur le respect des droits des créateurs face à l’usage massif des contenus par les systèmes d’IA générative. Les discussions avec les ayants droit sonttoujours en cours, notamment sous l’impulsion du Ministère de la Culture, mais nous sommes loin de parvenir à un accord. Nous nous demandons malheureusement si la voie judiciaire ne sera pas la seule manière d’engager des discussions concrètes sur une juste rémunération des créateurs et des producteurs.
Notre position, elle, reste inchangée : nous ne sommes pas opposés à l’innovation, bien au contraire. Mais nous ne sommes pas prêts à offrir nos films gratuitement aux systèmes d’IA générative. La création audiovisuelle doit être respectée et rémunérée : toute exploitation par l’IA générative doit faire l’objet d’une rémunération équitable pour les auteurs et les catalogues.
Depuis la parution du rapport Geffray, l’éducation au cinéma est au centre des discussions. Quel rôle y joue l’offre de films de répertoire ?
L’éducation à l’image est au coeur de nos préoccupations. Le SCFP soutient pleinement les dispositifs tels que « Ma classe au cinéma », qui jouent un rôle essentiel dans la formation du regard des jeunes spectateurs. Plus de la moitié des films proposés dans ces dispositifs sont des films de patrimoine, et les chiffres de fréquentation témoignent de leur succès. Selon le dernier rapport du CNC sur le bilan des dispositifs, cela représente tout de même 4,7 millions d’entrées en 2024-2025. Nous souhaiterions aller encore plus loin : pouvoir proposer davantage de films et être mieux associés aux choix, car personne ne connaît mieux que nous la richesse des catalogues.
À ce titre, nous sommes particulièrement fiers de l’initiative de l’un de nos membres, Gaumont, avec le programme « Alice et Léon », conçu pour accompagner enseignants et élèves de la maternelle au lycée dans la découverte du cinéma et de son patrimoine. Ce type de projet illustre parfaitement la contribution des catalogues à la transmission culturelle et à l’éducation des publics de demain.
Le rapport Geffray a confirmé l’importance de renforcer ces programmes, et la table ronde du Congrès FNCF a montré un consensus autour de leur pérennisation, malgré la question cruciale des financements. Pour nous, l’offre de films de répertoire est un outil décisif pour transmettre la diversité culturelle européenne, fidéliser les jeunes publics et préparer les spectateurs de demain.
Gaétan Bruel, président du CNC, sera présent au MIFC. Quels messages souhaiteriez-vous lui adresser ?
À l’occasion du MIFC, la présence de Gaétan Bruel sera un moment clé pour rappeler l’importance du patrimoine dans la stratégie du CNC. Depuis son arrivée, le président a donné un signal fort avec la signature d’un accord avec la BFI, intégrant explicitement la restauration et la préservation des oeuvres. Nous saluons cette orientation, qui inscrit le patrimoine dans une dynamique européenne et démontre qu’il peut être un levier d’avenir, et non un simple héritage.Nous savons par ailleurs que Gaétan Bruel est particulièrement sensible au patrimoine. Il n’est pas étranger à l’enveloppe complémentaire dont notre secteur a bénéficié récemment sur l’aide à la restauration, et nous tenons à l’en remercier. C’est un geste concret qui témoigne de son engagement et qui doit servir de base pour aller plus loin.
Mais les attentes demeurent élevées. Nous comptons sur le rôle de régulateur du CNC pour nous accompagner dans la programmation des films de patrimoine, en particulier à la télévision, où la réduction des cases dédiées – notamment sur France Télévisions – nous inquiète. Il estessentiel que la diffusion des oeuvres de répertoire soit garantie dans le service public, car elle participe à la diversité culturelle et à l’éducation à l’image.
Nous appelons également à être pleinement associés à toutes les discussions professionnelles où le patrimoine est utilisé comme monnaie d’échange dans les accords sur la production. Les catalogues ne peuvent être réduits à une variable d’ajustement : ils doivent être considérés comme un pilier de la politique culturelle et audiovisuelle. Pour nous, le patrimoine n’est pas seulement la mémoire du cinéma, c’est un outil stratégique pour construire l’avenir.
Selon les statistiques du CNC, 2 900 longs métrages de patrimoine (+ 20 ans) ont été exploités dans les salles. Comment analysez-vous ces chiffres ? Est-ce une bonne nouvelle pour le rayonnement de cette offre ou une éventuelle saturation de l'offre peut-elle pénaliser ce marché ?
Ces chiffres confirment une tendance de fond : le cinéma de patrimoine connaît une dynamique sans précédent. Le fait que près de 3 000 films de répertoire aient été exploités en salles est une excellente nouvelle pour la visibilité et le rayonnement de cette offre, qui ne cesse d’attirer de nouveaux publics, notamment les jeunes générations grâce aux cinémathèques, festivals et cycles thématiques. C’est plus de 200 films supplémentaires par rapport à l’année passée, qui était déjà une année record.
Il est vrai que la fréquentation globale recule légèrement, mais elle reste à un niveau très élevé, preuve que le patrimoine a toute sa place dans les salles aujourd’hui. Cette baisse s’explique avant tout par l’élargissement de l’offre : plus de films proposés, donc mécaniquement une dispersion des entrées. Plutôt qu’un signe de saturation, nous y voyons une confirmation de la vitalité du marché et de l’appétit des spectateurs.
Les résultats concrets témoignent de cette vitalité : Gaumont, qui fête ses 130 ans cette année, a généré plus de 100 000 entrées (billetterie CNC) en ouvrant largement son catalogue aux salles de cinéma, même pour une seule séance. Pathé détient le record d’entrées salles pour un film de patrimoine en 2024 : « Les Choristes », avec 65 000 entrées. Autre succès notable : « Le Nom de la rose » (TF1 Studio/Les Acacias) a enregistré plus de 47 000 entrées, tandis que la rétrospective Visconti portée par les Acacias a réuni plus de 34 000 spectateurs.
Ces réussites n’auraient pas la même ampleur sans le travail formidable des distributeurs avec qui nous collaborons, qui s’attachent à donner de la visibilité à ces films, à les accompagner et à les défendre avec conviction dans un marché toujours plus concurrentiel. De la même manière, le festival PLAY IT AGAIN, organisé chaque année par l’ADRC, reste un moment fort : il met en avant pendant dix jours, dans plus de 300 salles partout en France, une sélection d’oeuvres de patrimoine qui rencontrent à chaque édition un large public.
L’enjeu désormais est double : mieux accompagner les exploitants dans la programmation, pour éviter que certains films ne passent trop vite inaperçus, et renforcer la médiation autour des oeuvres, afin de soutenir la fréquentation. Car plus que jamais, le patrimoine est un formidable levier d’éducation à l’image, de diversité culturelle et de fidélisation des publics en salle.
Florian Krieg
© crédit photo : Vincent Bousserez
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici


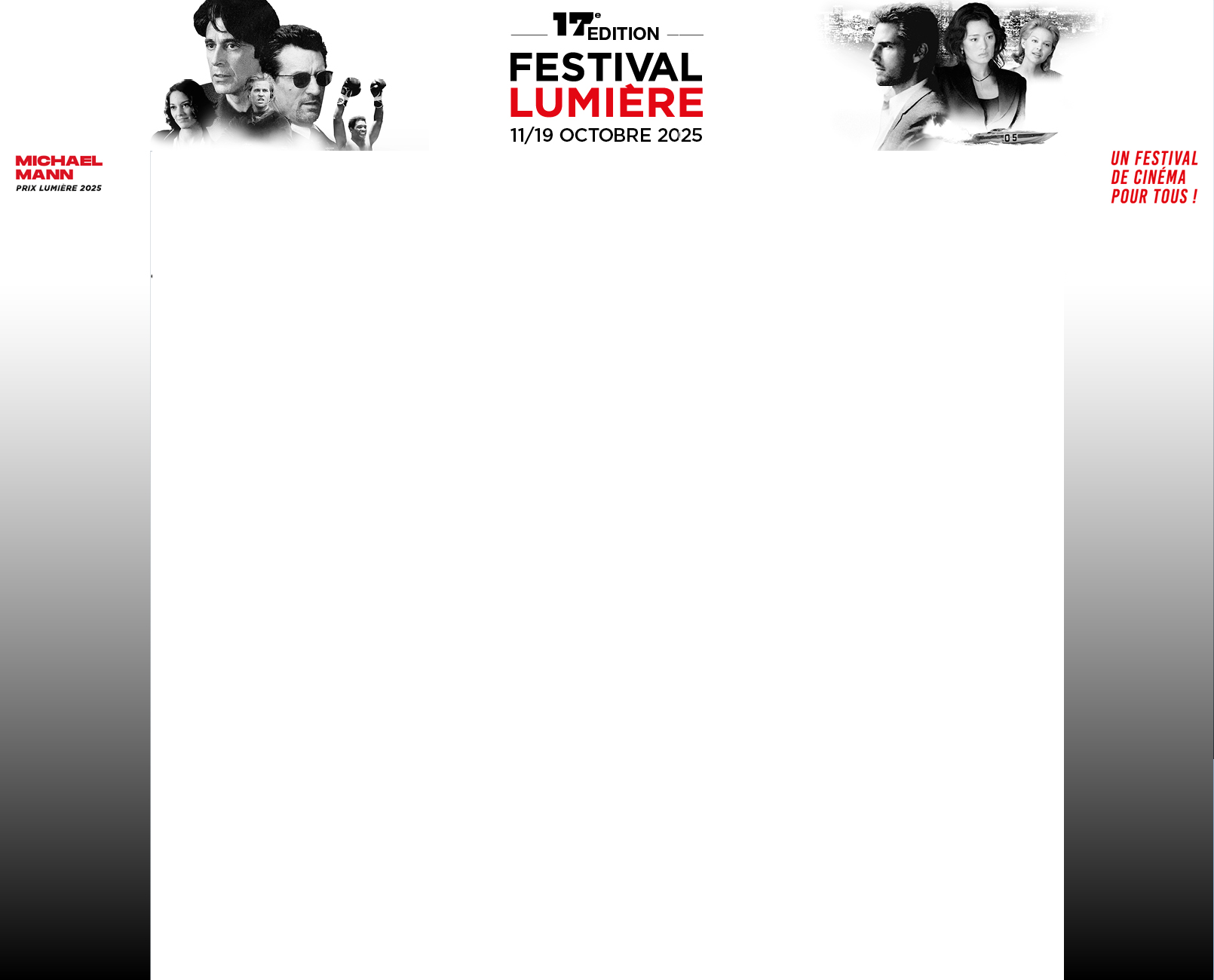




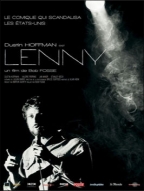 Lenny
Lenny